|
La commune de Marcellaz, que
l’on appelait aussi « Marcellaz en Genevois
» pour la distinguer de son homonyme du Faucigny ou encore
« Marcellaz le Royal » est devenue
Marcellaz-Albanais par décret du 25 octobre 1921.
Couvrant 1450 hectares, elle fait partie d'un vaste terroir
s'étendant d'Annecy à Alby.
Par décret du 8 juin 1923, la section de la Champagne est
achetée par la commune d'Hauteville-sur-Fier.
Le nom de
Marcellaz provient vraisemblablement du nom d’une villa
romaine,
résidence d’un propriétaire terrien de
l’époque gallo-romaine, du nom de Marcellus.
En 1880, on a retrouvé au hameau de Peignat quelques
substructions antiques en fort ciment formant des chambres.
Plusieurs autres noms de hameaux (Contentenaz,Germagny, Oilly) semblent
avoir leur origine dans le nom
de villae gallo-romaines.
D'autres domaines
furent probablement exploités à
l'époque du royaume burgonde,
eux aussi à l'origine de noms d'autres villages
(Faramaz,Joudrain).
Au Crêt-Dieu, furent découverts au 19ème
siècle des
tombeaux en molasse, témoignant de la probable
présence d'un cimetière burgonde.
Vers cette
époque, est créée la paroisse de
Marcellaz, dédiée à Saint Maurice.
L'épisode du martyr de Saint-Maurice à Agaune
dans le Valais (vers 300) a probablement
beaucoup servit à la propagation du catholicisme dans les
Alpes,
ce qui explique qu'un grand nombre de paroisse de la région
lui furent consacrées.
Bien que proche de Rumilly, elle était incluse dans le
décanat d'Annecy et son curé était
nommé par l'évêque.
Les revenus de la cure se constituait d'un petit domaine rural et des
dîmes, partagées avec les seigneurs.
Ils étaient estimés en 1728 à 750
livres. Le curé devait entretenir un vicaire.
Une église est bâtie
à Marcellaz vraisemblablement au 11ème
ou 12ème siècle,
à l’époque de l’essor
monastique.
Mentionnée en 1400, elle servira jusqu’en 1625. A
partir du 14ème siècle,
elle est visitée à neuf reprises par les
évêques de Genève
ou leur vicaire général . Elle comptait
quatre chapelles intérieures, fondées
par des familles nobles ou bourgeoises qui en assurent
l’entretien et en usent comme lieu de sépulture :
la chapelle Saint-Jean-Baptiste, la chapelle Saint-Sébastien
(entretenue par les nobles de l'Alée, seigneurs
de Songy), la chapelle du Saint-Esprit (entretenue par la
confrérie du Saint-Esprit) et la chapelle
Notre-Dame (entretenue par la famille Randollet).
Au
18ème siècle, la population de Marcellaz se
réunissait pour l'élection de son syndic
avec l'autorisation du châtelain de Montagny, mais la plus
grande partie de la commune
dépendait de la seigneurie d'Hauteville.
Les villages de Germagny et de la Mollière ressortent de la
seigneurie de Montrottier.
Le village de Chaunu appartient aux seigneurs de Lupigny dont le
château se trouve à Boussy.
Dès avant 1516, les seigneurs de Songy à
Saint-Sylvestre possèdent des biens à Montmasson
et jusqu'au 18ème
siècle, un domaine à la Mollière. En 1730, on compte 19 nobles
propriétaires à
Marcellaz alors qu'il n'y en avait pas un avant le 16ème
siècle.
De 1783 à 1792, c'est une somme de 14073 livres que les
habitants de Marcellaz ont engagé pour
s'affermir des droits seigneuriaux.
1561, RECENSEMENT DE LA POPULATION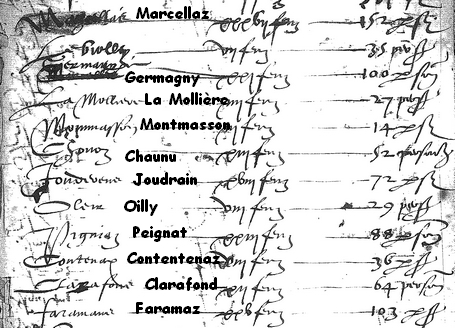
Après le traité de
Cateau-Cambresis (1559), le trésor du duché de
Savoie étant vide,
le Duc Emmanuel-Philibert institua le monopole d’Etat de la
vente du sel et sa gabelle (taxe sur le sel).
La consommation annuelle est fixée à environ 11,4
kg par an.
Pour obtenir une répartition équitable, on
procède en 1561 à un recensement paroisse par
paroisse,
listant pour chaque feu d’habitation personnes et
bétail, même si ce dernier
n’était pas taxé.
A Marcellaz, le dénombrement a eu lieu
entre 1561 et 1564 et fut
exécuté par quatre agents recenseurs successifs :
Maître Pierre Bojon,
lieutenant du châtelain d'Hauteville, François
Garin, Maître Jehan Mugnier,
notaire ducal, et Jaques Cursod, de Rumilly.
La paroisse a été divisée en douze
sections
correspondant aux principaux hameau du village : Marcellaz
(le chef-lieu), le Biolley
(le Biollet), Germagnye (Germagny), la
Mollière, Montmasson, Chonoz
(Chaunu), Jouderens (Joudrain), Oleyer
(Oilly), Pigneaz (Peignat), Contenax
(Contentenaz), Clarafons (Clarafond) et Faramans
(Faramaz).
A la lecture du dénombrement, on
constate que
les habitants hameau du Biolley de la paroisse d'Etercy ont
été comptabilisés
dans le recensement de la paroisse de Marcellaz alors que ceux du
hameau de la Champagne
furent comptés dans le recensement de la paroisse
d'Hauteville.
Marcellaz est alors une paroisse bien peuplée de 989
habitants*, répartis dans 181
familles.
Les hameaux les plus peuplés sont le chef-lieu (Marcellaz),
Faramaz, partagé entre la paroisse
de Sâles et de Marcellaz, Peignat et Germagny. On compte 26
foyers dits
" pauvres et misérables "
regroupant 95 personnes et on dénombre
50 domestiques, à savoir 19 hommes et 31 femmes,
employés par 33 foyers surtout à Germagny,
Chaunu, Peignat et Clarafond.
Au chef-lieu, où le bétail a
été
comptabilisé, 10 feux possèdent leur paire de
boeufs (soit plus du quart),
ce qui signifie que ces familles sont propriétaires de leurs
terres qu'elles labourent
elles-mêmes.
En dehors des cultivateurs (ou laboureurs), on compte un notaire
à Germagny,
qui est également le chatelain de la seigneurie de Lupigny
(à Boussy),
un barbier (chirurgien) à Contentenaz et deux
maçons à Clarafond.
Il y a également 4 prêtres habitant le chef-lieu.
Le curé de Marcellaz, messire Claude Germain, est
appelé "vicaire de Marcellax".
Les trois autres sont Pierre Randollet, Claude Chamey et Pierre Clavoz.
Les deux syndics habitent le premier, Louis Clavoz, au chef-lieu,
et le second, Mauris de la Fontayne, à Peignat.
Détail
du Recensement
pour la gabelle (1561-1564)
* En comptant les
42 habitants du Biollet, sans compter les 50 habitants de la Champagne.
|
1608, VISITE DE SAINT FRANCOIS DE SALES

Le 15 mars 1608, la paroisse de Marcellaz
reçoit la visite de l'évêque François
de Sales en personne.
Il est reçu par le curé Georges Cohendet et les
trois syndics Claude Viollet, Claude Paccard et Dominique Crosat
ainsi que par plusieurs notables.
L'évêque constate que l'église est en
mauvais état et demande aux paroissiens de faire
réparer les murs de la nef
et du clocher, de faire fermer à clef les fonds baptismaux
et de fournir une bannière et un parement d'autel.
Le curé est également invité
à s'occuper de la réparation de la toiture du
presbytère, de la couverture du tabernacle.
Les réparations doivent être effectuées
dans un délai de deux mois sous peine d'interdit,
entraînant la fermeture de l'église et la
privation des sacrements.
A cette époque, les chapelles de Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Sébastien, ruinées, avaient
été rasées depuis longtemps.
La chapelle du Saint-Esprit sera unie au maître-autel faute
d'avoir pu trouver un recteur.
La chapelle Notre-Dame doit être restaurée par les
Randollet.
La paroisse
compte alors 60 feux, soit environ 300 personnes,
c'est-à-dire
beaucoup moins que lors du dénombrement de 1561 : c'est la
conséquence
des nombreuses épidémies meutrières
qui touchèrent la région à la fin
du 16ème siècle.
|
|
1618, UN LOUP DEVORE UNE PERSONNE A MONTMASSON
 En
février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz
révèlent le décès
d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait
été dévoré par un loup
près
de la paroisse de Chapeiry. En
février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz
révèlent le décès
d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait
été dévoré par un loup
près
de la paroisse de Chapeiry.
L'acte de décès a vraisemblablement
été
rédigé par le curé de
l'époque Georges Cohendet.
La transcription de l'acte est la suivante :
« Le 9 février 1618 a
été enseveli au cimetière de Marcellaz
un pied et une partie de la jambe de Claude Anthoine fils
de Hilayre de Montmasson, lequel fils a
été dévoré
du loup auprès de Chapeiry le 7 dudit mois et n'a
été
trouvé autre partie dudit fils. »

|
1625, CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE EGLISE
La construction de la "nouvelle" église
de Marcellaz
débuta le 15 avril 1624. Elle se situait à
l’emplacement de l’église
actuelle mais orientée perpendiculairement.
Le clocher surmonte le porche d’entrée et le
chœur se situe à l’emplacement
de l’ancien cimetière (aujourd’hui
parking de l’église).
Elle reçoit la bénédiction le 27
janvier 1625
(bénédiction des cloches) par le
révérend Georges Cohendet,
curé de Marcellaz.
|
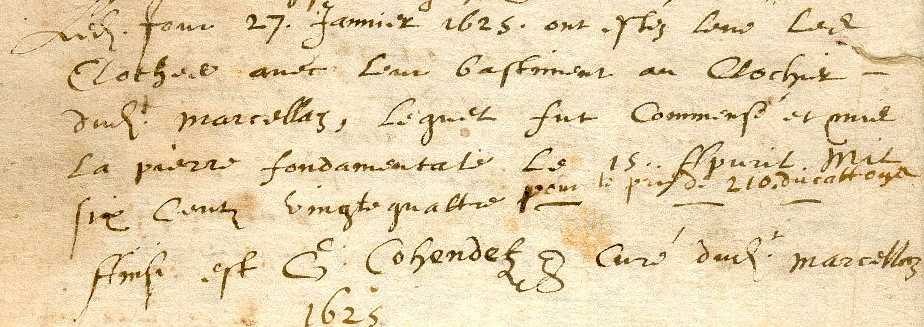
Bénédiction de l'église par le curé G. Cohendet
(archives paroissiales de Marcellaz)
|

Représentation de l'église sur le cadastre de 1730
et emplacement de l'église actuelle
(Archives Départementales 74) |
1647,
UNE NOUVELLE VICTIME D'UN LOUP A JOUDRAIN
Le
15 août 1647, on a inhumé au cimetière
de Marcellaz un fils de Guillaume Domenge de Joudrain qui avait
été enlevé par le loup et dont on n'a
retrouvé que la tête !
|
1673, INHUMATION
DANS LA CHAPELLE DU SAINT-ROSAIRE DE L'ÉGLISE
Le
14 novembre 1673, on a inhumé dans la chapelle du
Saint-Rosaire de l'église de Marcellaz, noble Mathieu
Roget,
décédé «en bon
chrétien» le 12 novembre.
La famille Roget posède la
maison-forte au chef-lieu du village de Marcellaz et a donc sa
sépulture dans la chapelle du Saint-Rosaire de l'église
paroissiale. 
Une note de
l'Armorial du comte de Foras suggère que cette
famille serait cousine des nobles Roget de Bonneville : « J'ai
reproduit, dans les croquis ci-dessus, deux pierres
sculptées que l'on retrouve sur une maison de Marcellaz et
dans l'église Notre-Dame d'Annecy. La première
paraît être de la fin du XVIe siècle; la
seconde, d'une époque un peu postérieure. La date
de ces pierres jointe au fait que les Roget possédaient,
dès avant 1583, des biens à Marcellaz, et
jusqu'en 1633, une maison dans la rue Filaterie à Annecy, me
font estimer que ces pierres concernent certainement la famille Roget
dont les armoiries se trouvent placées à dextre
sur chacune des pierres et sous une forme très semblable
à celle du cachet de 1635. Mais il est plus difficile d'en
faire une attribution précise à l'un ou
à l'autre des membres de cette famille. Car les biens de
Marcellaz échurent en partage à Jean Roget,
tandis que l'alliance figurée sur la pierre de Marcellaz,
semble être celle de Claude qui épousa Marie
Empereur. (...) La maison de Marcellaz aurait-elle
été, postérieurement aux partages de
1583, cédée par Jean Roget à son
frère Claude ? L'interprétation serait d'autant
plus plausible que Claude et ses enfants continuèrent
à vivre à Annecy, tandis que Jean vivait
à Bonneville où il testa en 1593; qu'il fut
enseveli à Chambéry, où l'avaient
appelé, en 1594, ses fonctions de sénateur, et
que, enfin, sa descendance continua à Bonneville. Claude, au
contraire, vivait à Annecy où il
possédait la moitié de la maison paternelle, rue
Filaterie. Ses enfants y vivaient aussi et je croirais volontiers que
la pierre de Notre-Dame d'Annecy, qui correspond sans doute
à une sépulture, doit être
attribuée à un de ses fils dont les alliances
nous sont d'ailleurs inconnues : soit à Spectable
François, avocat, qui mourut à Annecy le 3
décembre 1612; soit à Mathieu,
qualifié bourgeois d'Annecy en 1625, et qui, jusqu'en 1633,
posséda une partie de la maison de la rue Filaterie.»
« J'ai
reproduit, dans les croquis ci-dessus, deux pierres
sculptées que l'on retrouve sur une maison de Marcellaz et
dans l'église Notre-Dame d'Annecy. La première
paraît être de la fin du XVIe siècle; la
seconde, d'une époque un peu postérieure. La date
de ces pierres jointe au fait que les Roget possédaient,
dès avant 1583, des biens à Marcellaz, et
jusqu'en 1633, une maison dans la rue Filaterie à Annecy, me
font estimer que ces pierres concernent certainement la famille Roget
dont les armoiries se trouvent placées à dextre
sur chacune des pierres et sous une forme très semblable
à celle du cachet de 1635. Mais il est plus difficile d'en
faire une attribution précise à l'un ou
à l'autre des membres de cette famille. Car les biens de
Marcellaz échurent en partage à Jean Roget,
tandis que l'alliance figurée sur la pierre de Marcellaz,
semble être celle de Claude qui épousa Marie
Empereur. (...) La maison de Marcellaz aurait-elle
été, postérieurement aux partages de
1583, cédée par Jean Roget à son
frère Claude ? L'interprétation serait d'autant
plus plausible que Claude et ses enfants continuèrent
à vivre à Annecy, tandis que Jean vivait
à Bonneville où il testa en 1593; qu'il fut
enseveli à Chambéry, où l'avaient
appelé, en 1594, ses fonctions de sénateur, et
que, enfin, sa descendance continua à Bonneville. Claude, au
contraire, vivait à Annecy où il
possédait la moitié de la maison paternelle, rue
Filaterie. Ses enfants y vivaient aussi et je croirais volontiers que
la pierre de Notre-Dame d'Annecy, qui correspond sans doute
à une sépulture, doit être
attribuée à un de ses fils dont les alliances
nous sont d'ailleurs inconnues : soit à Spectable
François, avocat, qui mourut à Annecy le 3
décembre 1612; soit à Mathieu,
qualifié bourgeois d'Annecy en 1625, et qui, jusqu'en 1633,
posséda une partie de la maison de la rue Filaterie.»
Son fils Benoît Roget, avocat au Sénat de Savoie,
avait épousé en 1652, la sœur du
curé de Marcellaz, dont il aura au moins 9 enfants. Il sera
lui aussi inhumé dans la chapelle du Saint-Rosaire de
Marcellaz en 1716, ainsi que plusieurs de ses enfants.
Sur
le cadastre de 1730, le propriétaire de la maison est Pierre
Baud, marchand de Rumilly, qui avait épousé en 1717,
Marguerite Roget.
|
|
1696, UNE REVOLTE PAYSANNE AU VILLAGE DE FARAMAZ

Le 3 septembre 1696, François de
Montfalcon de Rogles,
comte d’Hauteville et possesseur de la maison forte de Rogles
de Marcellaz,
décide de délimiter et inventorier son fief,
assisté d’une escorte
armée, de deux commissaires à terrier et de deux
indicateurs de la paroisse
de Marcellaz, où il se rend. Là, le groupe aurait
sérieusement
malmené un paysan qui aurait refusé de donner le
nom de la parcelle
qu’il labourait. Mais l’après-midi,
c’est le même cortège
qui est attaqué par une centaine d’habitants du
hameau de Faramaz, à
la limite des deux paroisses de Marcellaz et Hauteville. Des hommes,
des femmes,
des enfants, des bergers, armés de cailloux et de serpes
entourent le seigneur.
Le comte et ses gens durent s’enfuirent
précipitamment.
L’un des indicateurs fut capturé,
frappé, insulté et
dépouillé de ses vêtements :
il lui fallut rentrer tout nu au château
d’Hauteville
où il se trouvait encore quatre jours plus tard.
|
1712?, L'AFFAIRE DU CRANE DE MARCELLAZ
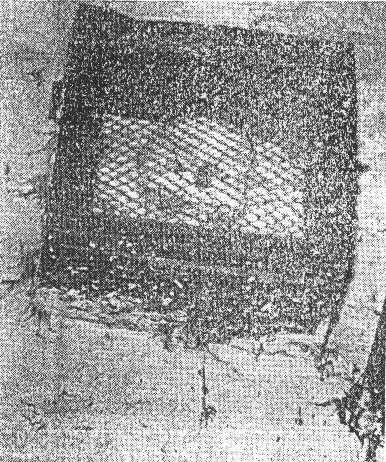

Dans l’église de Marcellaz, se
trouvait un crâne, scellé dans le mur du clocher
puis placé à l’intérieur du
clocher.
Une note de Croisollet (Histoire de Rumilly)
évoque l’origine de ce
crâne.
« On place vers
l’année 1712 un tragique
événement arrivé à
Marcellaz. Le seigneur du château d’Hauteville
avait à Marcellaz, au nord-ouest et près de
l’église, un castel qu’il habitait
pendant le temps des chasses. La fille du fermier devint
l’objet des coupables poursuites du seigneur pendant un
séjour à Marcellaz. Peut-être la pauvre
fille laissa-t-elle échapper une indiscrétion qui
compromit son confesseur. Peut-être aussi,
étonné de tant de vertus dans une simple
paysanne, le seigneur en attribuait-il la constance aux avis du
confesseur. Quoiqu’il en soit, le dit seigneur,
étant un jour à la chasse, rencontra, au
pré dit "Vers Prailles", le vicaire de
Marcellaz disant son bréviaire. Il y eut, à ce
qu’il paraît quelques paroles
échangées… Armer son fusil, le diriger
sur la poitrine du prêtre et faire feu, ce fut prompt comme
un éclair. Le vicaire tombe mort. Des paysans, qui
travaillaient aux semailles sur les collines environnantes, avaient
été témoins du drame qui venait de
s’accomplir dans la vallée. Ils
s’emparent du meurtrier. Son procès fut vite fait
et un arrêt du Sénat de Savoie porta
qu’il serait pendu au chef-lieu de Marcellaz, et que sa
tête serait clouée à
l’endroit le plus apparent de l’église
pour y rester à perpétuité. »
Le crâne se trouvait dans une niche
grillagée encore visible à
l’intérieur
du clocher (entrée de l’église avant sa
reconstruction)
mais fut volé en 1974. Légende ou
réalité ? les archives du
Sénat de Savoie
restent muettes à ce sujet, tout comme les archives
paroissiales de la commune…
|
1739, LA FOUDRE S'ABAT SUR LE CLOCHER DE L'EGLISE

Le 23 juin 1739, un violent orage éclate sur le chef-lieu de
Marcellaz.
La coutume est alors de sonner la cloche pour, croit-on,
éloigner
l'orage destructeur des récoltes.
Le sonneur de la paroisse est le jeune Etienne Fontaine,
âgé
de 22 ans, dont la famille vit au chef-lieu du village.
C'est alors que la foudre s'abat sur le clocher de l'église
et la cloche se décroche et tombe sur le jeune homme
qui meurt «étouffé par le feu du
ciel»,
selon l'expression du vicaire.
La transcription de son acte de décès,
rédigé par le vicaire Viollet est la suivante :
« Le vingt trois juin mille sept
cent trente neuf est mort sous
le cloché de l'église de Marcellaz
étouffé par le feu du ciel et le
même jour a été enseveli dans
le cimetière de la même église Etienne fils d'Aimé Fontaine
et de Claudine Guillermain âgé
d'environ vingt ans. ainsi est.»

|
|
1742, ACENSEMENT DE LA DÎME DE GERMAGNY
 La dîme
était une redevance en nature, correspondant à
une part de tous
les produits de la terre, et
perçue chaque année par l'Église. Au
cours des siècles, la dîme
était parfois inféodée à
des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,
au village de Germagny, le curé perçoit la
moitié de la dîme au
nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui
perçoit
l'autre moitié. L'acte
notarié suivant est l'«acensement»,
c'est-à-dire la concession de
la dîme à certains chefs de familles de Germagny
qui s'engagent à
verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz
et au seigneur de
Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la
dîme
auprès des habitants soumis à cet
impôt. On retrouve ici les plus
anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les
Vullioud,
les Viollet et les Michel. La dîme
était une redevance en nature, correspondant à
une part de tous
les produits de la terre, et
perçue chaque année par l'Église. Au
cours des siècles, la dîme
était parfois inféodée à
des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,
au village de Germagny, le curé perçoit la
moitié de la dîme au
nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui
perçoit
l'autre moitié. L'acte
notarié suivant est l'«acensement»,
c'est-à-dire la concession de
la dîme à certains chefs de familles de Germagny
qui s'engagent à
verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz
et au seigneur de
Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la
dîme
auprès des habitants soumis à cet
impôt. On retrouve ici les plus
anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les
Vullioud,
les Viollet et les Michel.
A
cette époque les coteaux sur lesquels se trouvaient
les villages de Germagny, Peignat et Contentenaz, comptaient de
nombreuses vignes.

|
|
1769, BENEDICTION DE LA GROSSE CLOCHE
Le 3 janvier 1769, a lieu la
bénédiction de la grosse
cloche de l'église,
par le curé de Marcellaz, Claude
Ducret.
Il est le parrain de cette nouvelle cloche qui reçoit le
prénom de « Claudine ».
Elle est montée dans le clocher de l'église
dès le lendemain.
|
1793, UN SOULEVEMENT ANTI-REVOLUTIONNAIRE
A partir de 1793, la Constitution civile du clergé
entre en vigueur en Savoie et, les prêtres qui refusent de
prêter serment sont poursuivis. A Marcellaz, le curé
Claude Ducret, âgé de 70 ans et curé de Marcellaz
depuis 28 ans, émigre. Le prêtre Sébastien
Bévillard sera établi missionnaire avant d'être
officiellement nommé curé de Marcellaz jusqu'à sa
mort en 1818.
Pendant cette période, la maison de Jean-François Viollet, au
hameau de Germagny, servira de refuge aux prêtres
réfractaires de la région et de lieu de culte
improvisé.
Le 18 août 1793, un grand nombre
d’individus de Marcellaz, ayant à leur
tête leur maire Louis Longeray, armés de
bâtons et de fusils, après avoir excité
les habitants des communes voisine à se joindre à
eux, sonnent le tocsin à leur passage sur la commune de
Sâles, où ils entreprennent d’abattre
l’arbre de la liberté. Ils arrivent
près du faubourg Saint-Joseph de Rumilly où ils
forment un rassemblement dirigé contre la
Société Populaire de cette ville. Ils ne se
dispersèrent qu’après avoir
été repoussés par la garde nationale
de Rumilly.
« Les
habitants de Marcellaz renouvelèrent leur délit
d’une manière plus éclatante le 22
août 1793, époque d’un
événement insurrectionnel à Rumilly,
mené par le royaliste François Collomb. Ils
ouvrirent à force la maison de détention de cette
ville, élargirent les détenus de leur
commune ; enfoncèrent les portes, avec
d’autres insurgés, de la maison commune ;
s’emparèrent des armes dont ils firent usage pour
poursuivre et incarcérer les patriotes ;
arrachèrent des mains du juge de paix des
procédures instruites contre les insurgés du 18
août ; proclamèrent ouvertement la
royauté ; et, enfin, se montrèrent
ouvertement les ennemis du gouvernement républicain et les
amis du royalisme. »
(séance du Conseil de Rumilly, 28 ventôse an VI )
La Société Populaire de
Rumilly fit faire beaucoup d’arrestations à
Marcellaz. Un grand nombre de personnes de cette commune furent
conduits dans les prisons de Chambéry. Le maire Louis
Longeray y resta six mois détenu.
1832, UN EXORCISME A MARCELLAZ
En mars 1832, deux jeunes filles d'une famille de
Marcellaz attirèrent la foule des curieux,
une dizaine d'ecclésiastiques et même un capucin
exorciste. Toutes les personnes qui s'approchaient du lit
des jeunes filles étaient frappées,
piquées, recevaient des poignées de paille, sans
que celles-ci interviennent.
L'opinion se divisa devant les faits. Pour les uns,
la plupart ecclésiastiques, qui tentent
et vérifient l'expérience plusieurs fois, il
s'agit de faits extraordinaires qui justifient un exorcisme.
Pour les autres, et notamment les «anti-prêtres
de
Rumilly», ils sont persuadés qu'il
s'agit
d'une supercherie montée par le clergé pour en
imposer et avoir des messes.
Comment cette affaire finit-elle ? la source ne le dit pas. Mais elle mit
dans l'embarras l'évêché d'Annecy
qui voyait dans l'exorcisme non un moyen d'enfler l'esprit follet et
ses facéties mais
de chasser un «esprit malin qui trouble le repos
d'une famille
chrétienne».
|
1842, CONSTRUCTION DE L'EGLISE ACTUELLE

C'est de 1842 à
1843 que fut construite l’église actuelle,
perpendiculairement à la précédente
par l’architecte Monnet, dans un style
néo-classique sarde.
L'édifice actuel a conservé sur son flanc le
clocher de 1625.
Les autels en marbre sont de MM. Adami et Jotterand, sculpteurs
lyonnais, les fonds baptismaux et la chaire du
sculpteur renommé Giraldi. L'église a
été consacré par Mgr Rendu,
évêque d'Annecy, le 19 octobre 1845.
Elle fut agrandie d'une travée en 1892 et
complètement renovée en 1963.
|
|
1890, UN INCENDIE RAVAGE LE VILLAGE DE MONTMASSON

Le
4 mars 1890, l'instituteur de Chapeiry rapporte dans son journal que
« presque
tout
le village de Montmasson, commune de Marcellaz, fut
détruit par un incendie. Le feu se communiqua d'une maison
à l'autre,
par les flammèches que la bise, assez forte à ce
moment, portait sur
les toits de chaume ». A la suite de cet
incendie, les
bâtiments et
maisons incendiés ont été reconstruits
« en pierre
et couverts en
ardoise ».
|
1914-1918, PREMIERE GUERRE MONDIALE
Les 64 soldats
morts pour la
France inscrits au monument aux morts de Marcellaz.
Le
château de Pieuillet
SOURCES
F.Croisollet, Histoire de Rumilly.
J.Y. Mariotte, Histoire des communes savoyardes, tome III.
J. Brunier, Bulletin des Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais,
numéros 14 et 17.
Archives paroissiales de Marcellaz
|

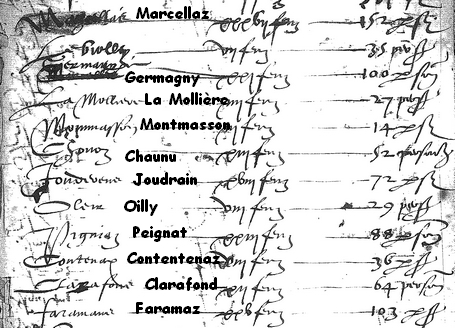

 En
février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz
révèlent le décès
d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait
été dévoré par un loup
près
de la paroisse de Chapeiry.
En
février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz
révèlent le décès
d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait
été dévoré par un loup
près
de la paroisse de Chapeiry. 
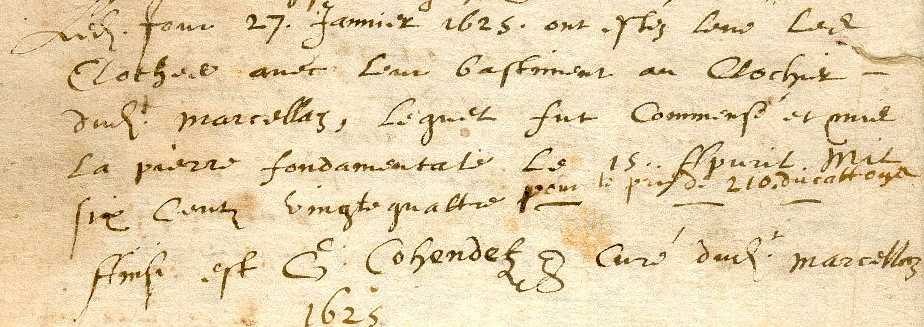




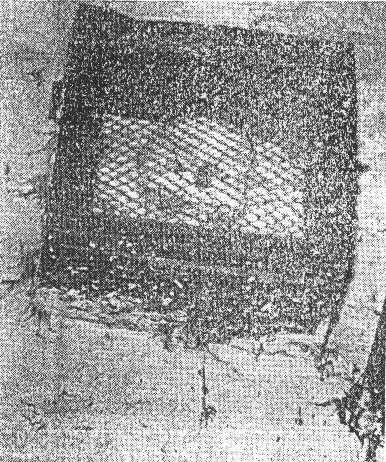



 La dîme
était une redevance en nature, correspondant à
une part de tous
les produits de la terre, et
perçue chaque année par l'Église. Au
cours des siècles, la dîme
était parfois inféodée à
des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,
au village de Germagny, le curé perçoit la
moitié de la dîme au
nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui
perçoit
l'autre moitié. L'acte
notarié suivant est l'«acensement»,
c'est-à-dire la concession de
la dîme à certains chefs de familles de Germagny
qui s'engagent à
verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz
et au seigneur de
Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la
dîme
auprès des habitants soumis à cet
impôt. On retrouve ici les plus
anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les
Vullioud,
les Viollet et les Michel.
La dîme
était une redevance en nature, correspondant à
une part de tous
les produits de la terre, et
perçue chaque année par l'Église. Au
cours des siècles, la dîme
était parfois inféodée à
des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,
au village de Germagny, le curé perçoit la
moitié de la dîme au
nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui
perçoit
l'autre moitié. L'acte
notarié suivant est l'«acensement»,
c'est-à-dire la concession de
la dîme à certains chefs de familles de Germagny
qui s'engagent à
verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz
et au seigneur de
Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la
dîme
auprès des habitants soumis à cet
impôt. On retrouve ici les plus
anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les
Vullioud,
les Viollet et les Michel.


